
Sur les grands axes du chemin de fer, les trains se succèdent à intervalles rapprochés. Le gros problème provient du fait qu'ils ne roulent pas tous à la même vitesse. Ces vitesses peuvent s'étaler de 80 km/h à 220 et il est évident qu'il ne suffit pas de déboiter sur la file de gauche pour doubler un train plus lent ! Il y a aussi les omnibus, qui s'arrètent toutes les 5 minutes; les trains de détails, qui manoeuvrent dans les gares ou ce qu'il en reste; les trains en détresse qui s'arrêtent subitement n'importe où !
Pour surpasser cette situation, il est évident qu'une organisation rigoureuse des circulations doit être effectuée, et que des décisions rapides doivent être prises devant les évènements imprévus.
C'est le travail effectué par les régulateurs.
L'organisation générale de la régulation
A début de chaque service (service d'été ou d'hiver), des graphiques de circulation sont tracés. Ces graphiques reprennent toutes les circulations prévues, régulières ou facultatives. Ils se présentent de la façon suivante.
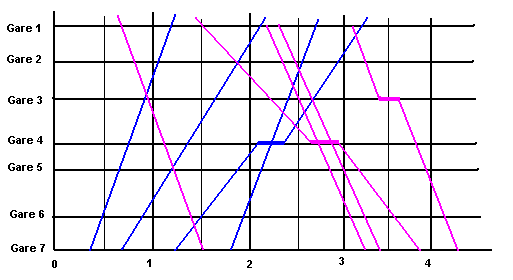
A gauche, verticalement, sont repris les points particuliers de la ligne, les gares, etc... En bas, horizontalement, sont reprises très précisément les heures et minutes pour une journée entière de 24 heures. Les lignes obliques représentent la marche des trains. On appelle ceci un "créneau" ou un "sillon". Chaque marche a son propre créneau, qui sera exécuté à la lettre si aucune anomalie ne vient perturber les circulations.
Ces marches sont ensuite reprises, train par train et à la 1/2 minute près, sous une forme dactylographiée. Elles constitueront les documents utilisés par les mécaniciens pour effectuer leur train. Une marche est généralement calculée avec une marge de régularité (+/- 10%). Cette marge de régularité permet aux conducteurs de rattraper le temps éventuellement perdu. Lorsque cette marge est réduite, on dit que l'horaire est "tendu" ou que le train est "serré". Les anciens trains postaux (disparus avec le reste !) avaient des marches très tendues, et obligeaient les conducteurs à travailler comme des sauvages ! Pauvres postiers ! Heureusement, ce n'était pas des midinettes !
Les régulateurs travaillent constamment avec le graphique sous les yeux, et retracent les marches réèlles des trains au gré des circonstances. Chaque régulateur a donc sous les yeux l'heure exacte de passage en n'importe quel point de la section de ligne qu'il contrôle.
Lorsqu'un train facultatif est mis en circulation, la régulation lui choisit une marche parmi celles déjà tracées. Si cela n'est pas possible, une nouvelle marche sera retracée intégralement de manière à s'incruster dans le graphique de circulation préexistant.
Pour faciliter l'établissement de ces graphiques, il arrive que des marches identiques soient regroupées dans une petite zone. Il s'agit de trains roulant à la même vitesse se suivant à courte distance, et on parle de "batterie" dans ce cas. Il n'est pas rare qu'un train de marchandises soit garé pour laisser passer une "batterie" de rapides.
Sur les lignes surchargées, comme le sont souvent les grands axes, les trains de marchandises sont souvent obligés de circuler de nuit, la journée étant très occupée par le passage des trains de voyageurs. Sur certaines lignes (en banlieue de Paris, par exemple), les voies sont doublées à l'aide de "bis". Il y aura une voie 1, et une voie 1 bis par exemple. Tous les trains portent un numéro différent, impair lorsqu'ils s'éloignent de Paris.
Le travail du régulateur
 Le régulateur est un véritable chef d'orchestre, et il est le seul à maîtriser tous les évènements qui surviennent sur la section dont il s'occupe. Il suit les trains en permanence, et vérifie la concordance de leur marche avec le graphique de circulation. C'est lui qui décidera de garer tel train à tel endroit, pour laisser passer tel autre, plus rapide. Il trace des lignes, prévoit les difficultés, et gère les circulations en fonction des installations dont il dispose.
Le régulateur est un véritable chef d'orchestre, et il est le seul à maîtriser tous les évènements qui surviennent sur la section dont il s'occupe. Il suit les trains en permanence, et vérifie la concordance de leur marche avec le graphique de circulation. C'est lui qui décidera de garer tel train à tel endroit, pour laisser passer tel autre, plus rapide. Il trace des lignes, prévoit les difficultés, et gère les circulations en fonction des installations dont il dispose.Bien que très contraignant, le travail des régulateurs a été facilité ces quinze dernières années, par l'apparition de l'informatique et des télécommandes. Auparavant, tout se passait par téléphone, et le régulateur demandait aux gares de garer tel train jusqu'à telle heure. Le chef de gare s'empressait alors de fermer ses signaux, tourner ses aiguilles (souvent en vélo !). Ces mêmes chefs de gare notaient l'heure de passage des trains et renseignaient, toujours par téléphone, le régulateur qui pouvait compléter son graphique.
Aujourd'hui, beaucoup de petites gares ont disparu, et les chefs de gare avec elles. Les trains sont suivis par des enclenchements de zones, signalisées sur le pupitre du régulateur. Les graphiques sont informatisés et défilent sur des écrans. Les voies d'évitement sont commandées directement par le régulateur, à distance.
Jadis, tous les trains roulaient à gauche, d'une façon générale. (sauf en Alsace !). Aujourd'hui, les nouvelles techniques permettent de faire rouler les trains sur la voie de droite, le temps d'être doublé par un train plus rapide. Cet avantage permet d'améliorer considérablement la circulation. Il s'agit d'Installations Permanentes de Contre Sens, très informatisées et sécurisées. Ces installations sont également très utiles en cas d'anomalies sur une voie.
Les nouvelles lignes à grande vitesse (les LGV) permettent de rouler indifféremment à droite ou à gauche.
Désormais, la majorité des trains sont équipés de la liaison "sol-train", (la radio). Cela permet des contacts directs entre les mécaniciens et les régulateurs, et des décisions plus rapides.
Mais malgré la modernité, le travail de régulateur reste éprouvant dans certains secteurs. Dans les moments perturbés, ces agents sont au bord de l'asphyxie. C'est pourquoi il leur arrive d'aller prendre l'air pour "refroidir" un peu !.