
A quoi servent les triages?
Les triages constituent une vaste toile d'araignée sur le territoire français, et en Europe. Les véhicules sont assemblés par groupes, qui vont ensemble vers un autre triage où ils seront à nouveau triés, etc... jusqu'au triage le plus proche de leur point de destination. A ce stade, ils seront ensuite distribués par des trains de détails.
Il faut savoir qu'il existe grosso-modo deux types de trains de marchandises.
Les trains complets
Ces trains sont formés à l'origine une fois pour toutes. Le train entier va vers la même destination et il s'agit en général de trains homogènes composés de matériel spécialisé. Ceci concerne les transports de masse comme le ballast, les céréales, les produits pétroliers, etc... Ces trains sont généralement très lourds (3000 tonnes, voire plus ! ), et ne sont pas triés.
Les trains de fret ou commerciaux
Sous cette dénomination apparaissent tous les trains formés de matériels divers, venant d'origines diverses, et allant vers des destinations diverses. Les wagons sont captés individuellement dans leur lieu d'origine, et sont distribués dans leur lieu de destination par des trains de détails. Les trains de détails sont des trains tout à fait normaux, mais ils s'arrètent partout, manoeuvrent partout. Une bonne partie de ces "détails" ont disparu avec les gares qu'ils desservaient, au profit des camions. C'est beau le modernisme!
Comment fonctionne un triage ?
Les triages apparaissent souvent comme des grands espaces désordonnés, voire délabrés, aux visiteurs qui ne connaissent pas leurs fonctions. Il y a des wagons partout, isolés ou en groupe, des petites cabanes souvent grisatres, des gens qui s'y promènent sans fonction apparente !
Un triage est en fait une véritable fourmilière, tout au moins pour ceux qui sont encore opérationnels à 100%, car les gestionnaires sont passés par là. Un triage est une grosse organisation, et les plus modernes relèvent d'une technologie de pointe assez sophistiquée, totalement invisible. Je tente ici de vous expliquer comment sont formés les trains de marchandises, et nous allons prendre pour exemple un triage fictif, représenté ci-dessous.
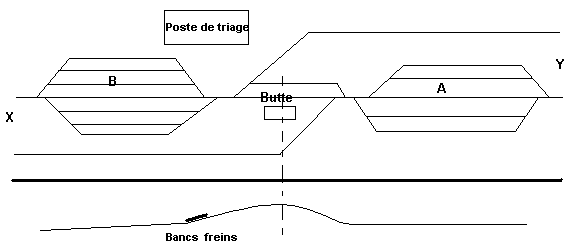
Dans notre schéma, le faisceau A est le faisceau de réception. Les trains à l'arrivée sont dirigés vers ce faisceau, qu'ils viennent de X ou de Y. La machine de traction est évacuée, puis le poste de triage prend ce train en main. Le faisceau B est à la fois le faisceau de triage et de départ. Entre les deux, une butte (une bosse) qui donnera l'impulsion nécessaire aux wagons qui "tomberont" sur leurs voies.
Le relevé du train
En général, les trains sont relevés au départ, et ce relevé est transmis par telex au triage de destination. Si ce relevé n'est pas fait, pour un détail par exemple, où tout est mélangé, un agent va commencer par relever la totalité des véhicules, au vu de l'étiquetage des wagons. Il relèvera également un certain nombre de critères comme la masse, la fragilité, etc...
 Le dételage
Le dételageCe relevé étant effectué, tous les véhicules vont être coupés, séparés. Le train reste en fait homogène, mais les wagons ne sont plus solidaires les uns les autres. C'est le travail du dételeur, qui sera facilité si le mécanicien a bien "tassé" son train à l'arrivée, pour éviter que les attelages soient sous tension. Le frein est vidé, et tous les wagons sont désserrés.
Le débranchement
Dès que ce travail est effectué, une machine de manoeuvre, reliée par radio au poste de débranchement, se place du côté opposé à la butte et pousse le train à vitesse réduite (+/- 4 kmh) vers le faisceau de triage B. Les wagons passant en butte prennent seuls leur élan en descendant de l'autre côté. Il n'ont plus de freinage propre, et roulent librement.
A cet instant, la technologie entre en oeuvre (mais il existe encore des postes manuels). En fonction du relevé, l'itinéraire de réception du wagon est tracé au moment ou il tombe de la butte, et les différents aiguillages tourneront devant ses roues, au fur et à mesure de son avancement. Les automatismes ont beaucoup simplifié cette opération qui est loin d'être facile. Les véhicules tombent à intervalles rapprochés, et il faut tourner l'aiguille avant les roues, et non dessous, mais après le passage du wagon précédant.
Derrière la butte, se trouve un banc de freinage qui freine les wagons en leur donnant tous une vitesse de chute constante. Là encore, ce n'est pas si facile. Ces bancs de freinage pincent les roues pour freiner les véhicules, mais il n'est pas question de les arréter, car le suivant ne tardera pas. Les wagons tombent donc vers leurs voies de formation.
Les buttes sont équipées d'une voie parallèle, qui permet de faire la liaison entre les faisceaux sans passer par la butte. Cette voie permet de trier les véhicules spéciaux, surbaissés par exemple, qui ne passent pas en butte. Dans ce cas, c'est la machine de manoeuvre qui conduit elle-même ce wagon sur sa voie de destination.
Les caleurs
Ces caleurs sont des agents qui attendent les wagons pour les stopper avant qu'ils ne heurtent la rame déjà constituée. Ils utilisent des cales spéciales, et s'occupent de plusieurs voies à la fois. Les voies de destination sont annoncées par haut-parleur, ou par talkies, afin que ces caleurs puissent s'organiser, et juger très vite de la charge et de la vitesse, et où placer la cale. Ce travail, très ingrat, est très dangereux. Dans les grands triages, où les wagons tombent a vitesse rapide, les caleurs sautent de voies en voies devant ces wagons qui ne s'arrêterons pas, quoiqu'il arrive , et ceci par tous les temps ! Beaucoup de caleurs ont été estropiés par ces wagons aveugles! C'est pourquoi les triages modernes possèdent des dispositifs très sophistiqués de freinage automatique, qui amènent le wagon à mourrir au but, sur la rame en attente.
La formation du train
Tous ces wagons tombant sur leurs voies respectives forment des trains. Les véhicules vont être raccordés, et un relevé du train effectué. La charge, la longueur, le freinage seront relevés ici très précisément. Ces renseignements serviront à établir le bulletin de composition nécessaire au mécanicien. Dès que ce train est formé, il est "visité". Ce travail est fait par des visiteurs qui arpentent les deux côtés du train en s'assurant que tout répond bien aux normes de sécurité (gabarit, arrimage des chargements, état du matériel, etc...). Ces visiteurs effectuent également une vérification du frein à l'aide d'une installation fixe. Si le temps manque, cette opération sera effectuée avec le mécanicien et la machine de route avant le départ du train. Le mécanicien, dans ce cas, sera avisé qu'il doit effectuer un essai "complet".
Le train est désormais prêt au départ. Dans notre triage fictif, il pourra partir vers X ou Y.
Vous voyez donc que beaucoup d'agents interviennent dans ces opérations, qui s'enchaînent très précisément dans une organisation rigoureuse. Compte tenu des délais impartis, il arrive que ces opérations soient de véritables courses contre la montre. Si vous y réfléchissez un peu, vous vous apercevez que pour qu'un train suive son horaire normal, il faut qu'une quantité d'agents de tous les horizons (releveurs, dételeurs, aiguilleurs, freineurs, caleurs, visiteurs, conducteurs, etc...) fassent leur travail sans faillir, et il faut que la technique suive sans anicroche. C'est souvent une question de minutes ! Il arrive que la machine de route se mette en tête, alors que des wagons tombent encore sur la queue du train ! Nous sommes assez loin du cliché habituel de décontraction que l'on prête facilement aux agents de la SNCF !